Ali Moussa Iye est Djiboutien. Docteur en sciences politiques de l’Institut d’études politiques de Grenoble, il a été chercheur à l’ISERT, journaliste, chef du département économique à la Présidence et directeur de la presse et audiovisuel dans son pays avant de rejoindre l’UNESCO en 1996.
Il a occupé plusieurs fonctions au sein de l’UNESCO, notamment comme coordinateur du programme « Culture de la paix » de l’UNESCO dans la Corne de l’Afrique, spécialiste dans le programme sur la démocratie et enfin responsable du programme de lutte contre le racisme et les discriminations.
Il est actuellement chef de la section du dialogue interculturel. Il est notamment responsable de deux projets important de l’UNESCO : le projet « La Route de l’esclave » et le projet des histoires générales et régionales de l’UNESCO (Histoire de l’Humanité, Histoire générale de l’Afrique, Histoire générale de l’Amérique latine, Histoire générale des Caraïbes, Les différents aspects de la culture islamique et Histoire des civilisations de l’Asie centrale). Il est notamment le coordonnateur d’un important projet sur l’utilisation pédagogique de l’Histoire générale de l’Afrique pour rénover l’enseignement de l’histoire africaine dans les écoles primaires et secondaires de l’Afrique et développer des contenus pédagogiques à intégrer dans les programmes scolaires des pays africains. Ce projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec l’Union africaine.
Parallèlement à ses fonctions à l’UNESCO, il poursuit ses recherches sur le droit coutumier et les traditions démocratiques des peuples de pasteurs et notamment des Somali-issa.
Après votre célèbre livre, Le verdict de l’arbre, et d’autres ouvrages moins connus des Djiboutiens, vous venez de publier un nouveau livre consacré à l’ogaas. Pourriez-vous nous présenter de manière succincte son contenu ?
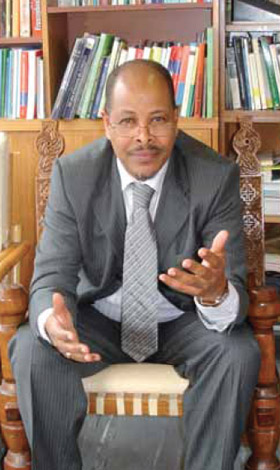
Cet ouvrage est le résultat d’un travail collectif que nous avions effectué il y a plus de dix ans pour sauver du péril une tradition originale sur la transmission du pouvoir royal chez les Issas. Les vicissitudes de la vie et le manque de possibilité d’édition ont fait que cette recherche n’ait pu être publiée avant. Je suis donc heureux que le livre ait pu sortir au moment même de l’intronisation de l’ogaas. Heureuse coïncidence qui certes a calmé certaines de nos inquiétudes sur l’accomplissement de la procédure de recherche du nouvel ogaas mais qui en a soulevé d’autres sur la pérennité de cette tradition au vu des changements socioculturels en cours. Le livre décrit la procédure et le protocole pour la recherche, le choix, le rapt, l’intronisation, l’installation et l’éducation du roi issa. Utilisant une méthodologie rigoureuse pour la collecte et la sélection des informations récoltées auprès des dépositaires de cette tradition, il établit les différentes étapes à suivre pour assurer la succession de l’ogaas. C’est un livre qui se veut à la fois normatif, pour rappeler les normes et les règles à respecter dans ce processus et pédagogique pour offrir un ouvrage court et facile à lire. A travers ce livre, nous avons aussi voulu apporter des éclairages sur certains points de controverse et de dispute qui ont retardé le lancement de la procédure, comme sur la durée réglementaire de la vacance du pouvoir, sur les premiers actes à accomplir après la mort de l’ogaas… Nous étions mus par la volonté d’ancrer, de conserver dans l’écrit une tradition complexe et volatile que la rareté de son utilisation mettait en danger d’oubli et de falsification. Certes, l’écrit a tendance à figer les choses, mais il a l’avantage aussi de servir de référence fort utile pour la postériorité.
Que représente ce travail par rapport à celui que vous aviez effectué sur le xeer ?
Ce travail est davantage une monographie qui actualise et enrichit les recherches que j’avais faites sur le xeer il y a plus de 22 ans.
A l’époque, face à la masse des connaissances disponibles, j’avais choisi de donner une vue holistique de ce contrat et opté donc pour une approche analytique, en indiquant quand il le fallait les pistes pour des recherches ultérieures. J’espérais que d’autres après moi allaient explorer ces pistes. Hélas, il est dommage que peu de recherches aient été effectuées pour approfondir et enrichir ce travail. J’espère que la nouvelle génération de chercheurs comblera ce vide.
Pour revenir à votre question, je dirais que la royauté issa n’est qu’une des principales institutions du système complexe du xeer. A la fois constitution politique, droit pénal et code de conduites sociales, le xeer est en effet un ensemble de principes philosophiques, de dispositions politiques, de règles juridiques et des prescriptions sociales qui en fait un système holistique d’une incroyable cohérence. Le xeer, qui a été créé pour répondre à une situation d’anarchie et de violence ayant suivi la décadence des cités-états musulmans de la Corne de l’Afrique, a apporté des avancées considérables en matière d’organisation sociopolitique. Il a introduit déjà au XVIe siècle une nouvelle philosophie du politique, des droits de la personne humaine, de la justice et du libre arbitre disent les paradigmes de la science politique occidentale nous servant de modèle aujourd’hui.
Contrairement à ce que pensent beaucoup des Issas, ce n’est pas seulement le lien du sang qui les unit mais surtout le Xeer, c’est-à-dire la loi, qui les assemble en tant que confédération ou peuple constitutionnel.
Avec sa conception du pouvoir royal, sa philosophie de l’homme, son modèle de démocratie et de justice, son processus de prise de décision, le xeer issa constitue une tradition humaniste qui pourrait contribuer beaucoup au débat global actuel sur l’universalisme et l’humanisme. Avec d’autres systèmes comme le xeer, l’Afrique possède là des sources de connaissance et des ressources culturelles inutilisées qui pourraient lui permettre de rompre avec les héritages coloniaux, de renouer avec le génie créateur de ses peuples et de forger des alternatives endogènes à son mal développement et sa mal-gouvernance.

Le fait d’avoir été pendant 15 ans sans ogaas a-t-il eu des conséquences pour la communauté issa ?
Toute vacance de pouvoir crée un vide que certains essaient de combler comme ils peuvent, en s’arrangeant avec la tradition. Cependant, pour notre cas, c’est moins la durée de la vacance qui importe que les circonstances historiques dans lesquelles elle est intervenue.
L’ogaas Hassan Hirsi, paix en son âme, nous a quitté à un moment très critique pour notre région : transition politique et même dynastique en Éthiopie après la chute de Mengistu, naissance d’un nouvel État, l’Érythrée, sortie de la guerre civile à Djibouti et surtout l’écroulement de la Somalie qui a sombré dans l’anarchie et la violence. Les Issas qui sont éparpillés dans trois de ces pays étaient donc entraînés dans ces bouleversements. C’était donc une période incertaine où ils avaient le plus besoin d’un chef spirituel pour les guider dans la tourmente. Il faut dire aussi que l’ogaas Hassan Hirsi a eu une longue vie et a régné plus de 64 ans. Il a disparu alors que les grands sages charismatiques issas étaient soit déjà morts soit trop vieux pour assurer la relève. Ce concours de circonstances a conduit à un sentiment de désorientation, à des errements et des compétitions entre clans qui ont affaibli la confiance des Issas en leurs institutions traditionnelles. Il est indéniable que cette désorientation a eu des conséquences morales et sociales sur la communauté issa.
Comment selon vous la recherche du nouvel ogaas et son intronisation se sont déroulées ?
Pour résumer mon avis, je dirais que cela s’est passé dans l’improvisation, la précipitation et la confusion, malgré la bonne volonté et la mobilisation de beaucoup de gens. C’est la première fois dans l’histoire des ogaas que les Issas de la ville, c’est-à-dire les citadins qui sont moins soumis au xeer, ont joué un rôle aussi important dans le processus, marginalisant en quelque sorte ceux de la brousse. Je pense qu’une répartition plus équilibrée des rôles et des compétences entre ces acteurs aurait certainement aidé à une meilleure organisation.
Malgré ces ratés, le plus important c’est de savoir que les sages ont porté leur choix sur un jeune ogaas qui montre le charisme et l’aura que l’on attend d’une telle fonction. Certes, il est encore en période de test, mais beaucoup d’Issas pensent que Dieu a guidé le choix des anciens.
Comment expliquez-vous l’engouement et l’enthousiasme soulevés par le choix et l’intronisation de l’ogaas ?
J’ai été agréablement surpris par l’enthousiasme et la mobilisation du public pour le processus. Je croyais que les gens seraient préoccupés par leurs soucis quotidiens et donc quelque peu indifférents.
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cet engouement. La recherche de l’ogaas est intervenue à un moment où les Issas, déboussolés par l’évolution des choses dans toute la région, traversaient une crise d’identité, de sens et d’unité. L’exode accéléré vers les villes, les sécheresses répétées qui ont déstructuré le mode de vie pastoral, la dislocation du commerce inter frontalier, la compétition pour le pouvoir moderne, l’introduction du khat jusque dans les campements, tout cela a mis à mal l’existence et l’identité des Issas en tant peuple constitutionnel formé autour du xeer. Le besoin de l’ogaas, qui s’est si fortement exprimé aussi bien chez les Issas de la brousse que ceux de la ville, démontre donc leur aspiration à un leadership spirituel et moral qui puisse les guider à travers ces écueils. Cela montre toute la légitimité que l’institution royale Issa a pu conserver malgré des transformations socioculturelles.
Que pourrait justement apporter le nouvel ogaas et comment un tel pouvoir traditionnel peut-il se pérenniser face aux changements que vous avez mentionnés ?
Pour comprendre ce que l’ogaas pourrait apporter, il est utile de revenir aux fonctions qui lui sont assignées dans le xeer. Il joue un triple rôle : il sert d’arbitre et maintient l’unité de la confédération ; il prie pour son peuple et le protège contre les calamités et enfin il béni les décisions des Assemblées et prodigue des conseils. Or, les gens semblent attendre beaucoup plus que cela de leur Ogaas. Ils ont exprimé le besoin d’un modèle de vertu, de droiture qui puisse les aider à s’élever au dessus d’eux-mêmes et des contingences de la vie quotidienne ; ils semblaient réclamer un père qui leur indique le bon chemin, un arbitre qui puisse recueillir leurs doléances et leur rende justice. Bref, les Issas d’aujourd’hui projettent toutes leurs frustrations sur leur ogaas. Je ne pense pas que ce dernier puisse avoir les moyens de répondre à toutes ces attentes. Je dirais qu’une focalisation excessive sur sa personne risquerait même de modifier le xeer car l’ogaas n’est qu’un rouage du système. En personnalisant ainsi son pouvoir, on risque de marginaliser les autres institutions, le Guddi et le Gandé, qui délibèrent sur les affaires publiques et sont habilités à prendre les décisions. Cela peut paraître paradoxal mais pour pérenniser la royauté Issa, il faudra donc rétablir d’une part l’autorité et la légitimité des Assemblées des sages et d’autre part la confiance des Issas en ces institutions. Pourquoi me diriez-vous ? Parce que si l’Ogaas prend trop de pouvoir et d’importance, sa charge pourrait susciter les envies et les convoitises. On penserait aux éventuels privilèges que générerait ce changement de statut. L’ogaas issa perdrait ainsi ce qui fait sa spécificité, l’absence de pouvoir et de privilège et il deviendrait comme les « chefs traditionnels » mis en place par les colons qui jouissaient de quelque pouvoir coercitif et de privilèges attractifs. C’est par conséquent tout l’édifice du xeer qui en serait bouleversé et menacé. Comme vous voyez, une « idolatrisation » de l’ogaas pourrait accélérer sa disparition. Il y a là de quoi méditer en attendant que le jeune ogaas prenne réellement les reines de ses fonctions. D’ailleurs, la question de l’éducation et de la formation spécifi que à donner au nouveau roi me semble cruciale pour l’avenir de cette institution. Quel type de savoir et de savoir faire doit-il acquérir dans le nouveau contexte socioculturel et politique de la région ?
Ne pensez-vous pas, en tant que chercheur, que dans un pays multiethnique comme Djibouti le fait de traiter de sujets dits « ethniques » pourraient contribuer à exacerber les divisions dans la population ?
Tout d’abord, je voudrais rappeler que ce n’est pas la diversité des ethnies ou de tribus qui posent problème dans les pays, c’est l’instrumentalisation politique de ces différences qui est la cause principale des confrontations. Etudier de manière détachée et objective la spécificité d’un groupe ethnique pour faire connaître son patrimoine me semble une démarche utile et nécessaire. Par contre, si cette démarche vise à essentialiser le particularisme de ce groupe, à l’opposer de manière irréductible aux autres groupes, en oubliant d’analyser par exemple le contexte et le processus historique qui les ont produit, oui, il y aurait là une dérive dangereuse.
C’est pourquoi, dans mes recherches, j’ai toujours tenu à rappeler les traits et l’histoire communs que les Issas partagent avec les autres groupes voisins pour expliquer les similitudes et les différences. Je voudrais rappeler que la négation de la diversité ethnique et tribale, telle que l’ont pratiqués les jeunes Etats africains juste après leur indépendance, pour promouvoir l’unité et la cohésion de leurs jeunes nations, a été un leurre et une grave erreur selon moi. On a voulu imposer le modèle de l’Etat-nation hérité de l’Europe qui pourtant fut à la source des guerres terribles entre les Européens, y compris lors de la première et la seconde guerre mondiales. Or, ce modèle ne pouvait correspondre à la réalité de la foisonnante diversité de l’Afrique. Notre continent a produit dans sa longue et riche histoire d’autres modèles de vivre-ensemble dans un même État qui a su réconcilier diversité culturelle et unité politique. Je pense aux grands empires multiculturels, multiethniques et multiconfessionnels qui ont éclot en Afrique, dans l’ancienne Egypte, au Mali, au Ghana, au Congo. Aujourd’hui, des pays comme les Etats-Unis d’Amérique, la Nouvelle Zélande, le Canada, ont démontré la pertinence de ce modèle de l’unité dans la diversité. Le travail effectué par l’UNESCO sur les concepts de diversité culturelle et le pluralisme culturel permet de mieux saisir la fécondité de la diversité si un vrai dialogue interculturel est facilité dans les pays. Pour finir sur ce point, je dirais que la Somalie offre un exemple tragique dont nous devons tirer les leçons. Si l’homogénéité ethnique, culturelle et religieuse était un atout pour réaliser une société harmonieuse, la Somalie serait un paradis. Or, c’est l’inverse qui s’est produit. En comparaison, les pays les plus stables dans le monde sont des pays multiraciaux, multiculturels et multiconfessionnels. La recherche sur la diversité permet justement de dépasser les illusions unitaristes et de réfléchir à des nouvelles alternatives. Il y a là aussi matière à méditation.
Comment une telle tradition pourrait-être mieux valorisée dans un État moderne ?
Un double défi se pose à nous tous. Le premier est de trouver une juste place à de telles traditions dans les institutions même de l’État et de la République. La dichotomie qui est souvent instaurée entre la sphère étatique moderne et la sphère communautaire traditionnelle provoque une sorte de schizophrénie chez les gens qui expliquerait certains comportements incohérents. Il faut trouver les moyens d’intégrer dans le système politique, juridique, éducatif les valeurs et les principes, et l’expertise, bref la philosophie du politique et du droit héritée de nos traditions comme le xeer issa et le droit coutumier afar. Plusieurs expériences pour valoriser et utiliser ces traditions comme des ressources culturelles existent en Afrique et peuvent nous servir d’exemple, notamment au Botswana, en Zambie, au Ghana, au Rwanda… Ces expériences ont permis d’introduire un pluralisme politique, juridique et institutionnel qui permet de dépasser les défaillances des institutions héritées de la colonisation.
Le second défi est celui de la transmission de ces traditions aux nouvelles générations d’autant plus qu’elles ne sont véhiculées que par voie orale. Le système éducatif moderne ne les prend pas en compte et a tendance à former des jeunes coupés de leurs racines et même éduqués dans le mépris de leur culture. Il est donc important de créer des circuits de transmission de ces traditions en les intégrant dans les programmes scolaires à tous les niveaux que cela soit primaire, secondaire, ou bien encore universitaire, mais aussi dans l’éducation informelle à travers l’audiovisuel : radio, télévision, ou bien encore l’internet.
Pour ne pas laisser cette mission au seul État et préserver l’autonomie des institutions traditionnelles, il est important que la société civile se préoccupe aussi de cette préservation. C’est pourquoi, je suis un des premiers à avoir préconisé la création d’une Fondation de l’ogaas pour s’occuper de la promotion du xeer et du dialogue avec les autres traditions juridiques du pays et de la région. J’ai même travaillé sur les statuts pour une telle fondation. Il faudrait aussi utiliser les possibilités qui existent au niveau international pour promouvoir ces types de patrimoine.
Une tradition comme le xeer mérite largement de figurer dans la liste mondiale du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Propos recueillis par Mahdi A.
Bravo Mr Ali Moussa Iye pour votre contribution a l’egard de votre communaute !
Les adresses courriel ne sont pas affichées.




