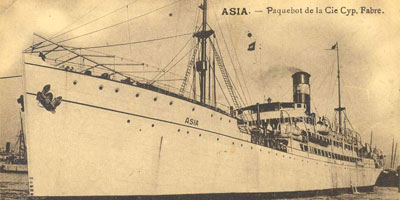J’ai consacré ces huit dernières années à l’étude des frontières à Djibouti, des territoires qu’elles définissent et des hommes qu’elles identifient [1]. Ces recherches se sont basées principalement sur des sources originales, issues des archives diplomatiques et coloniales françaises, italiennes et britanniques, et des récits d’acteurs, d’observateurs et d’analystes.

Le territoire autour du golfe de Tadjoura n’est ni pensé, ni nommé, en tant que tel avant l’installation française dans le dernier quart du XIXe siècle. Auparavant, les structures sociales et politiques qui peuplent, découpent et utilisent cet espace ne le conçoivent pas comme particulier ou distinct. Selon les moments soit il est divisé, soit il participe à des ensembles plus larges. Seules les villes de Tadjoura et Zeila semblent être des points d’habitat stable repérés dans les sources anciennes.
L’entité politique contemporaine « Djibouti » [2] correspond à un territoire et une identité créés par des interventions extérieures durant la période coloniale, qui s’imposent aux sociétés et aux évolutions historiques locales sans les nier. Les frontières nationales djiboutiennes sont élaborées en trois phases. D’abord des négociations entre Européens dans les années 1880 définissent ses bornes littorales [3]. Puis, jusqu’à la Première Guerre mondiale, dans une relation entre un Etat africain, l’Ethiopie, et un Etat colonial, la France, au cours de laquelle le premier est contraint de reculer régulièrement. Enfin, des années 1930 à 1950, se déroulent des négociations où les parties semblent égales. Si les habitants semblent à première vue absents, ils apparaissent néanmoins à plusieurs étapes. D’abord ils permettent le repérage des ressources (puits, routes…), indiquent les toponymes et participent souvent aux délimitations sur le terrain. Ensuite ils interviennent dans la délimitation d’autres territoires, en particulier les espaces administratifs organisés pour permettre la gestion et le contrôle des hommes. Enfin ce sont eux qui subissent les conséquences des créations frontalières.

Les frontières nationales
Après l’occupation européenne des côtes occidentales du débouché sud de la mer Rouge dans les années 1880, les points frontaliers littoraux entre les colonies sont déterminés en 1888 au sud (Loyada) et en 1891 au nord (Douméra). Ce n’est qu’après la défaite italienne à Adwa, et la reconnaissance conséquente de l’Ethiopie comme un acteur des relations internationales, qu’une première proposition frontalière est élaborée en mars 1897 dans un accord franco-éthiopien. Basée sur des cartes peu précises, elle ne peut indiquer qu’une intention, mais marque déjà un territoire beaucoup plus étendu que celui alors occupé par la France. Au-delà de cet espace politique, le territoire de colonisation française s’étend avec la réalisation du chemin de fer, au point qu’en 1906, le ministère des Colonies annonce une superficie de 120 000 km2 pour la CFS, qui s’étendrait alors symboliquement jusqu’à Dire-Dawa, voir Addis Abeba. Cette vision est consacrée par l’accord dit tripartite (franco-italo-britannique) du 13 décembre 1906 qui partage l’Ethiopie en zones d’influences européennes. L’acceptation par l’Ethiopie d’un système de « capitulations » en janvier 1908, qui rattache pénalement les ressortissants européens à l’autorité de leur consul, confirme les limites de la souveraineté éthiopienne.
C’est à cette époque qu’est reconnue sur le terrain la frontière septentrionale de la colonie, finalement délimitée par un accord du 10 juillet 1901 entre le cap Douméra et Daddato. En janvier 1900, la France et l’Italie avaient déjà convenu de laisser indivise l’île de Douméra. En avril 1934, le tripoint entre le Somaliland, l’Ethiopie et la CFS est aborné à Djalello, au terme de six mois d’une négociation où les trois protagonistes sont des acteurs de même qualité des relations internationales.

Dans les années 1930, commence la conquête progressive de l’intérieur du territoire de la Côte française des Somalis par des éléments militaires opposés à des groupes autochtones, en particulier ceux identifiés comme les Ulu’tós et les Adkaltos. Les affrontements s’intensifient durant la Seconde Guerre mondiale et culminent avec l’assassinat de plusieurs membres d’un groupe familial, les Kabbobás, à la suite de la mort d’un sous-officier français lors d’une opération extra-judiciaire de capture de bétail. Cet événement sert de prétexte à une ultime extension française vers l’ouest et la création d’un poste militaire au col d’Afambo. Cette fabrication frontalière prend une tournure originale entre 1936 et 1940, après l’occupation de l’Ethiopie par l’Italie. Les deux puissances coloniales entreprennent de prendre des gages territoriaux et les fortins français et italiens s’enchevêtrent alors autour de la frontière et dans le Hanle. Cet épisode de la « guerre des postes » fourni le cadre du roman publié par le journaliste italien Dino Buzzati à son retour d’Ethiopie en 1940, Le Désert des Tartares.
Il faut plus de dix ans de négociations franco-éthiopiennes, entre 1944 et 1955, pour que la frontière entre les deux pays soit abornée entre Djalello et Daddato. Cette frontière, bien que négociée entre deux acteurs de plein exercice des relations internationales, membres fondateurs des Nations unies, entérine un nouveau recul éthiopien par rapport aux traités du XIXe siècle. L’Ethiopie est contrainte à faire des concessions dans un domaine central pour elle, la définition de son territoire, faute de pouvoir mobiliser des ressources externes, alors que pour la France il ne s’agit que d’un enjeu périphérique. Bien qu’il s’agisse d’une négociation inégale, les Français doivent néanmoins symboliquement renoncer à leur demande maximale qui était de conserver le poste d’Afambo.
Il faut noter que la frontière est abornée jusqu’à Daddato, départ de la frontière érythréo-éthiopienne fixée à la fin du XIXe siècle. L’Ethiopie refuse d’intervenir sur la partie qu’elle qualifie d’érythréenne du tracé, malgré la fédération des deux territoires décidée par l’ONU en 1952. C’est dans les années 1960 qu’une modification des limites administratives internes de l’Ethiopie place le tripoint franco-éthio-érythréen au sommet du mont Moussa ’Ali, position confirmée par la décision de la Commission de délimitation des frontières entre l’Érythrée et l’Éthiopie en avril 2002 [4].
Au final, les 590 kilomètres des frontières nationales contemporaines de la République de Djibouti, si elles ne correspondent pas directement à la continuation de réalités ante-coloniales, s’inscrivent dans des évolutions historiques qui font aussi intervenir des réalités locales. Cet ancrage est sans doute une des raisons qui expliquent leur continuité malgré les tensions auxquelles elles sont soumises depuis l’indépendance du pays.
Les frontières internes
Il existe de nombreuses autres frontières dans l’espace djiboutien. Nous avons évoqué la frontière ferroviaire, d’abord axe de pénétration français dans la Corne puis, surtout après 1959, porte maritime de l’Ethiopie, dont le rôle est renforcé depuis 1998. D’autres constructions sont aussi importantes, comme les divisions administratives du territoire. L’étude de leurs évolutions permet de mettre en évidence des zones négociées, aux statuts évolutifs, entre les circonscriptions.

Avant l’occupation effective du territoire à partir de la fin des années 1920, seule une tautologie défini des districts « Issa » et « Dankali » qui ne sont de toute façon pas administrés en dehors de la zone du chemin de fer. Entre 1927 et 1949, quatre espaces émergent progressivement, centrés autour d’Ali Sabieh, Dikhil, Tadjoura et Obock, outre bien sûr la ville de Djibouti. Ces territoires et leurs limites sont porteurs d’enjeux politiques et identitaires, qui s’imposent aux habitants. Le premier devient le « cercle issa », symbole d’une « identité ethnique » pensée comme unifiée et homogène. Le second, au contraire, se veut zone de contact, territoire partagé entre des groupes aux attributions identitaires diverses et emmêlées. Les deux espaces septentrionaux représentent plus ou moins les structures politiques identifiées au moment de l’installation coloniale. La pérennité de ces délimitations au-delà de l’indépendance montre là aussi qu’elles ne sont pas déconnectées de demandes sociales.
Des niveaux administratifs inférieurs sont aussi fabriqués, en particulier autour d’As’Ela et de Yoboki, afin de territorialiser des « attributions ethniques » et de marquer les hommes, identifiés et limités à un espace. En effet, le premier est en charge des habitants identifiés comme Debnés, le second s’impose à ceux qualifiés d’Adorassous.
Bien qu’elle n’ait pas d’existence administrative ou légale, une autre frontière marque la fin de la période coloniale et les premières années de l’indépendance : le barrage qui enserre la ville de Djibouti à partir de septembre 1966. Long de 14 kilomètres, composé de plusieurs rangées de barbelés et d’une barrière métallique, parsemé de 23 miradors gardés par l’armée, il est officiellement chargé d’empêcher les migrants de pénétrer dans la ville. Durant les quinze années de son existence, la population urbaine triple, ce qui montre que sa fonction est en fait de créer de l’hétérogénéité dans un espace homogène afin de légitimer le maintien d’une structure politico-militaire de contrôle de la population. En lien avec des pratiques administratives, en particulier l’attribution de nationalité, il participe à la fabrication, ou à la recomposition, des identités individuelles et collectives.
Pourquoi des frontières ?
En partant des frontières, j’ai trouvé des territoires qui m’ont amené aux habitants et donc à proposer l’ébauche d’une histoire des Djiboutiens. Comme les territoires, les frontières sont des constructions humaines – sociales et politiques – insérées dans des contextes historiquement datés. Elles participent de la coercition que les Etats exercent sur leurs habitants, de la définition des premiers et de l’identification des seconds. La continuité des frontières au-delà du temps colonial montre l’incrustation dans la réalité sociale et politique des territoires, y compris symboliques, qu’elles définissent.
Cette approche a permis de confirmer l’historicité des structures sociales djiboutiennes, même si les détails et les modalités de leurs constructions demandent à être étudiés beaucoup plus précisément. Loin de reproduire des réalités sociales « traditionnelles », donc immuables, comme le propose la doxa coloniale qui décrit une Afrique sans histoire, la société djiboutienne est bien le résultat de processus historiques qui recomposent dans un va et vient continu les représentations et leurs utilisations.
Les points qui restent à étudier sont beaucoup plus nombreux que ceux ébauchés ici. Pour aller plus loin dans la compréhension historique de la société djiboutienne il faudra de nouvelles recherches, à partir certes des sources déjà utilisées, mais surtout en allant en chercher de nouvelles, orales et écrites, à Djibouti et dans les pays limitrophes (Éthiopie, Somalie, Yémen, Égypte…). Il est de la responsabilité des futurs chercheurs issus de l’université de Djibouti de prendre en charge leur histoire.
Simon Imbert-Vier , Centre d’études des mondes africains (CEMAf)
[1] Ces travaux ont fait l’objet d’une publication récente : Imbert-Vier (Simon), Tracer des frontières à Djibouti. Des territoires et des hommes aux XIXe et XXe siècles, Karthala, Paris, 2011.
[2] Nous appelons « Djibouti » le territoire autour du golfe de Tadjoura, nommé « Côte française des Somalis » de 1896 à 1967, puis « Territoire français des Afars et des Issas » avant de devenir la « République de Djibouti » en juin 1977.
[3] Les textes définissant les frontières djiboutiennes sont disponibles sur le site djibouti.frontafrique.org.
[4] Voir le site de la commission d’arbitrage www.pca-cpa.org, consulté le 4 mai 2011.
Les adresses courriel ne sont pas affichées.