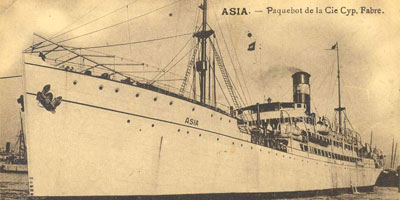Le régime de l’indigénat est souvent réduit à une juridiction pénale d’exception imposée à une partie des habitants des colonies françaises entre 1881 et 1946 [1]. L’étude du statut juridique spécifique des personnes définies comme « indigènes » en Côte française des Somalis permet de mettre en évidence un ensemble plus large, composé de deux principaux éléments distincts : un statut pénal et des procédures civiles [2]. Le premier comprend deux système répressifs qui ne s’appliquent qu’aux dits « indigènes », en plus éventuellement du droit qualifié de métropolitain, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale : la justice indigène et la justice administrative. Ces deux systèmes, formellement distincts, sont souvent confondus en fait. De plus, à partir des critères d’identification des personnes, sont mis en place des statuts juridiques différenciés en matière de droit civil et de citoyenneté qui sont maintenus après la disparition des juridictions pénales.
Cet article étudie de façon empirique ces différents aspects du système judiciaire et administratif qui s’appliquent de façon discriminatoire à une partie de la population de la colonie française autour du golfe de Tadjoura, en décrivant les textes puis en essayant d’apercevoir les pratiques. L’enjeu est de montrer la confusion entre les différents régimes juridiques auxquels étaient soumis les « indigènes », et donc l’impossibilité de les dissocier dans la perception qu’en avaient les acteurs, dans leurs pratiques et leurs effets. C’est pourquoi l’analyse se poursuit après la disparition formelle du régime pénal, et même au-delà de l’indépendance jusqu’à la dernière manifestation du statut, pour tenter de mettre en évidence des continuités sur une longue durée.
Le statut pénal des indigènes en CFS (1887-1946)
La CFS semble être le dernier territoire colonisé par la France en Afrique concerné par la mise en place de la justice administrative ou « disciplinaire » dite de l’indigénat, lorsqu’en 1912 le gouvernement décide d’y appliquer un décret de 1887 qui organisait ces pratiques au Sénégal [3]. Auparavant, il existe déjà une justice pénale différenciée pour les « Européens et assimilés » et les indigènes, qui relèvent en théorie de trois justices différentes (indigénat, tribunaux indigènes et français).
En 1887, l’organisation d’un « service judiciaire » [4] prévoit que « les tribunaux d’Obock se conforment à la législation française » (art. 13) sans distinguer les habitants en matière pénale [5]. Il est modifié en 1889, afin de préciser que les « indigènes […] ne sont pas justiciables […] de notre législation, souvent en contradiction avec leurs mœurs et leurs usages » [6].
En conséquence, pour les délits et contraventions, ils relèvent d’une « juridiction spéciale jugeant sans procédure et s’inspirant des coutumes du pays ». Les crimes relèvent des tribunaux « européens ». En 1894 [7], des « juridictions mixtes ou indigènes » sont maintenues pour les affaires « pénales intéressant soit les indigènes entre eux, soit les indigènes conjointement avec des Français, Européens ou assimilés » (art. 11).
En 1900, il est décidé que « la juridiction de ces tribunaux s’étendra sur tous les habitants de la Côte française des Somalis, quelles que soient leur race ou leur nationalité » [8].
Cependant, devant la juridiction de premier degré, « dans les affaires intéressant exclusivement les indigènes, les décisions des tribunaux sont rendues conformément aux us et coutumes du pays » (art. 6). La juridiction criminelle « statue conformément aux dispositions de la loi pénale métropolitaine » (art. 18), mais il existe une procédure particulière pour les « crimes politiques » commis par les indigènes. Dès 1904, comme « l’expérience a démontré que la suppression complète des tribunaux indigènes présentaient certains inconvénients » [9], des tribunaux spécifiques aux indigènes sont créés, où la justice est rendue par un administrateur « suivant les coutumes locales » (art. 30) dans les formes « des coutumes et usages locaux » (art. 38). Le texte juge nécessaire de rappeler que « les peines et châtiments corporels demeurent supprimés » (art. 39). Seuls les Européens bénéficient des garanties de la législation métropolitaine, en particulier du bénéfice d’un avocat et d’une procédure contradictoire. C’est donc en 1912 qu’est promulgué en CFS le décret de 1887 « relatif à la répression par voie disciplinaire des infractions commises par les indigènes du Sénégal », qui organise un régime répressif supplémentaire.
Un arrêté local [10] précise les procédures de cette troisième juridiction pénale, dite administrative, spécifique aux indigènes. Elle ne s’applique pas aux pratiques de la « coutume », mais à vingt-sept délits spécifiques qui sont jugés pratiquement sans appel par un représentant de l’autorité administrative avec des sanctions maximales de 15 jours de prison et 50 francs d’amende [11]. Des peines exceptionnelles, en particulier l’internement y compris hors de la colonie et les sanctions collectives, peuvent également être prononcées par le gouverneur. En 1914 [12], la procédure des tribunaux indigènes est précisée, dont les modalités de l’appel en matière pénale (« répressive »). Les textes ne sont ensuite plus modifiés pendant dix ans, si ce n’est, en 1922 [13], la création d’un « tribunal d’homologation » qui sert d’appel aux tribunaux indigènes et a l’ambition de codifier la « coutume » [14]. En 1924 [15], la « police administrative » ou « disciplinaire » qui s’applique aux « indigènes non justiciables des tribunaux français » est unifiée dans les colonies françaises d’Afrique [16] afin de rapprocher « l’action toute exceptionnelle de l’autorité administrative du régime normal » pour les infractions qui ne sont pas « de la compétence des tribunaux indigènes » (art. 10). La liste des « infractions spéciales aux indigènes » passe en CFS à trente cas, puis progressivement à trente-neuf en 1930, avant de revenir à vingt-sept en 1939. Les pouvoirs exorbitants du gouverneur (internement et sanctions collectives) sont confirmés pour les délits politiques (insurrection, etc.).
En 1927, au vu des « progrès constants de la société indigène » un texte particulier réorganise la seule « justice indigène » en CFS, avec l’objectif affiché d’« apporter aux justiciables indigènes le maximum de garantie, tout en respectant étroitement les coutumes » [17]. Outre la codification de cette « coutume » par la publication des décisions de l’homologation, en matière pénale il prévoit une possibilité d’appel systématique, mais le recours à un avocat reste impossible et cette justice est toujours rendue par un administrateur statuant en juge unique.
La réalité de la justice pénale des indigènes en CFS
La « justice pénale indigène », si elle a principalement deux formes différentes jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, administrative et judiciaire, est en fait exercée par les mêmes personnes. Comme c’est toujours le responsable du poste administratif, civil ou militaire, qui est seul en charge de rendre la justice, pénale ou administrative, la distinction entre « indigénat » et « justice indigène » n’est pas nette, et encore moins perceptible, certainement, pour le justiciable. Comme le relevait le géographe Jean Suret-Canale au moment des indépendances, « la justice indigène prolonge les pouvoirs de l’administration en matière d’indigénat » [18] . Les archives des cercles ont en grande partie disparu, ce qui rend difficile une description précise de la mise en oeuvre concrète de cet ensemble de législations répressives en CFS. Nous savons seulement qu’en 1932, le cercle de Djibouti jugeait en moyenne 440 affaires « à l’indigénat » chaque mois, pour une population d’environ 15 000 habitants, et qu’en 1936, les condamnations semblent quantitativement du même ordre [19]. On constate par ailleurs que le code pénal ne s’applique pas aux indigènes hors de la ville de Djibouti. En matière pénale, les commandants de cercle ne rendent pas la justice mais organisent le paiement d’indemnités compensatoires collectives (appelées « dia »), y compris pour les meurtres [20]. Un rapport de 1944 établi même une balance des compensations entre des miliciens autochtones et des nomades en fonction des « pratiques coutumières » de calcul des indemnités. Bien que, dès 1934, le gouverneur a fixé comme objectif d’amener les criminels indigènes devant un tribunal [21], il faut noter que dans les années 1950 encore cela n’est pas toujours le cas [22]. En 1953, les familles demandent même le payement de la « dia » après un meurtre commis à Marseille [23]. Dans la ville de Djibouti, après des affrontements politiques entre « issas » et « gadaboursis » qui font plusieurs dizaines de morts en 1949, des négociations se déroulent sur le payement des « dias », en parallèle à l’inculpation de responsables présumés. Outre ces situations, les plus nombreuses et en quelque sorte judiciarisées, on peut documenter quelques cas d’exactions ou de voies de fait par l’administration :
– en 1930, pour des raisons politiques, le gouverneur libère le cadi de Djibouti au nom de l’indigénat alors qu’il est incarcéré pour escroquerie par le procureur [24]
– en 1937, « le capitaine [Peri] commandant le cercle de Dikkil aurait attaché un prisonnier en plein soleil sur une tôle pendant trois jours, sans boire, sans manger » [25] ; il meurt des suites de ce traitement et deux de ses parents qui protestent sont condamnés à dix ans de prison. Malgré les conclusions d’une enquête administrative qui prône la mansuétude sans envisager de sanctions contre le capitaine, le gouverneur estime que la mort est due à une gangrène consécutive à un ligotage trop serré et il refuse tout allègement des condamnations.
– entre 1934 et 1945, la conquête de ce qui deviendra la partie occidentale de la CFS entraîne des affrontements avec un groupe nomade qui causent, selon l’administration, la mort de trente-huit Ulu’tós et neuf miliciens [26]. Ces combats justifient la mise en application de sanctions collectives (amendes, interdictions du territoire) au titre de l’indigénat et de « confiscations » de bétail qui engendrent de nouvelles tensions. On trouve des mentions de ces prédations par les représentants des autorités coloniales, civiles ou militaires, jusqu’au début des années 1950.
– en 1943, les hommes d’un groupe familial autochtone, les Kabbobás, sont pratiquement exterminés au cours d’un affrontement armé suivi d’assassinats de prisonniers lors d’une « corvée de bois » réalisée à l’instigation des officiers du cercle.
D’autres sanctions exceptionnelles relèvent de décisions politiques du gouverneur, liées à la conquête militaire de l’intérieur du territoire dans les années 1930 et pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1928, le « vizir » de Tadjoura, Habib Húmmad, est déporté à Madagascar, officiellement pour avoir été l’instigateur d’un guet-apens [27] mais en fait pour l’empêcher de succéder au « sultan » Mahámmad Arbâhim, mort en août 1927 ; il est autorisé à revenir en CFS vers 1934. En 1931, le « sultan » Lo’oytá Húmmad et le « vizir » Ali Húmmad du Goba’ád sont à leur tour déportés à Madagascar ; la « chefferie » est supprimée pour aider à la mise en œuvre de la pénétration française [28]. Le premier meurt en exil en 1932, le second revient en CFS en 1937. Ces exemples confirment que la justice pénale indigène n’est pas chargée de maintenir un ordre social en sanctionnant des violations de règles formelles codifiée par le droit. C’est un instrument politique de guerre et de conquête, qui vise parfois simplement à effrayer les habitants pour les soumettre et donc peut devenir objectivement terroriste [29].
Les procédures civiles et l’identification des indigènes (1887-1981)
Les procédures civiles sont d’une part des procédures d’enregistrement (état civil : naissance, mariage, divorce, décès ; dons et successions ; prêts et nantissements) et des procédures contentieuses (en matière civile ou commerciale). Il y a ici aussi un empilement de juridictions spécifiques aux indigènes (« musulmane », indigène et européenne). Les procédures d’enregistrement, qui paraissent neutres, sont en fait déterminantes pour l’identification des individus, et donc pour établir quelle est la juridiction dont ils dépendent.
Les textes que nous avons évoqués qui régissent les « tribunaux indigènes » prévoient également des procédures civiles. Le décret de 1887 [30] qui ne fait pas de distinction entre les habitants en matière pénale, précise que « sont maintenues, en matière civile, les juridictions indigènes actuellement existantes » (art. 15), sans les détailler. Le décret de 1904 [31] prévoit que « les tribunaux indigènes connaissent […] de toutes les affaires civiles ou commerciales entre indigènes ou assimilés » et statuent « suivant les coutumes locales » (art. 30). Le code civil ne s’applique donc pas aux indigènes, sauf si un Européen est concerné. En matière de mariage, divorce, succession, paternité, filiation, serment, ce sont des « cadis » nommés par le gouverneur qui jugent. En 1914, un arrêté [32] qui fixe la procédure des tribunaux indigènes prévoit la possibilité de contrainte par corps en matière civile (art. 20). En matière d’état civil, en 1935 un décret créé un « état civil indigène » [33] dans la seule ville de Djibouti ; il n’est étendu aux cercles de l’intérieur qu’en 1951 [34]. Il est mis en œuvre sous la seule responsabilité de l’administration, et « des punitions disciplinaires pourront être infligées aux indigènes qui, sans motif valable, ne se seront pas conformés aux prescriptions du présent arrêté » (art. 34). Nous sommes toujours dans une « exception indigène », à la limite du pénal et du civil.
Selon le décret du 20 avril 1927, « sont indigènes au sens du présent décret et justiciables des juridictions indigènes : les Somalis, les Danakil, les Arabes et tous les individus originaires de la Côte française des Somalis ou des pays limitrophes ayant dans leur pays d’origine un statut analogue à celui des indigènes énumérés au présent article » (art. 2) [35]. En 1945, un incident démontre que cette définition est inopérante. Après que le consul d’Éthiopie à Djibouti se plaint d’avoir été expulsé d’une tribune interdite aux « indigènes » lors d’une rencontre sportive, une note de service indique que « les Éthiopiens ne sont pas des indigènes mais les ressortissants d’un pays voisin » [36]. Elle démontre en réalité l’impossibilité de la distinction matérielle et la limite de l’assignation.
Il n’existe pas de solution de continuité entre la population de la Côte française des Somalis et celle de l’Éthiopie indépendante, les frontières sont même alors encore en cours de négociation. L’identification des « indigènes » ne peut être qu’une décision arbitraire puisque toutes les descriptions objectives sont impossibles. A fronts renversés, après la Seconde Guerre mondiale, cette question devient celle de l’accès à la nationalité, et donc au droit au séjour et au travail pour les migrants. Elle devient centrale à partir de 1960, avec l’accession à l’indépendance puis l’union des Somalies italiennes et britanniques dans le projet de constituer une « Grande Somalie » qui inclurait la CFS. Cette tension se concrétise dans les trois référendums successifs sur l’indépendance en vingt ans, en 1958, 1967 et 1977. L’accès à l’indigénat, et à la nationalité conséquente qui apporte la citoyenneté et le droit de vote, devient la clé de la souveraineté sur le territoire. Se mettent alors en place une succession de structures et de procédures pour identifier les indigènes français, en particulier autour de manipulations administratives de l’état civil. Elles sont basées sur des fabrications identitaires élaborées dans des allers-retours entre des situations locales et des reconstructions idéologiques. Ce processus d’assignation des indigènes trouve sa dernière expression lorsqu’en 1981 la première loi djiboutienne sur la nationalité [37] prévoit qu’« est djiboutien, ainsi que ses enfants mineurs, l’individu majeur, au 27 juin 1977 qui, par suite de sa naissance en République de Djibouti, était français au sens des lois encore en vigueur sur le territoire ». Ce sont les « indigènes », inventés durant la domination française, qui deviennent les Djiboutiens.
Conclusion
En Côte française des Somalis, petit territoire dont la préhension porte peu d’enjeux internes pour la France, le régime de l’indigénat a montré deux facettes principales. D’abord un système discriminatoire de séparation et d’identification des habitants et d’attribution de droits et devoirs, ensuite un outil politique de contrôle du territoire et de ses habitants. Avec ses contradictions, il a joué un rôle dans la fabrication de la « djiboutienneté ».
Simon Imbert-Vier
[1] Pour une présentation générale de son application dans les colonies africaines, voir Asiwaju (Anthony) [1979], « Control Through Coercion. A study of Indigenat regime in French West African Administration, 1887-1947 », Bulletin de l’IFAN, série B, 41 (1), p. 35-71 ; Merle (Isabelle) [2004], « De la « légalisation » de la violence en contexte colonial. Le régime de l’indigénat en question », Politix, vol. 17, n° 66, p. 137-162 -[www.persee.fr] ; Mann (Gregory) [2009], « What was the Indigénat ? The ‘Empire of law’ in French West Africa », The Journal of African History, Cambridge, vol. 50, n° 3, p. 331-353.
[2] Cet article est basé sur une présentation effectuée au cours de journées d’études à Paris en novembre 2011 sur « Le régime de l’indigénat et ses métamorphoses : histoire d’un dispositif impérial répressif » : « Particularités du statut de l’indigénat en Côte française des Somalis (1887-1981) ».
[3] Décret du 19/7/1912, promulgué le 20/8/1912, rendant applicable à la CFS celui du 30/9/1887. Ce dernier texte, inspiré d’un décret de 1881 sur l’Indochine, sert de modèle en la matière pour toutes les colonies françaises d’Afrique sub-saharienne.
[4] Décret du 2/9/1887.
[5] Ils sont distingués en matière civile par l’article 15.
[6] Décret du 2/6/1889, exposé des motifs.
[7] Décret du 4/9/1894.
[8] Décret du 19/12/1900, exposé des motifs et article 5.
[9] Décret du 4/2/1904, exposé des motifs.
[10] Arrêté du 11/9/1912.
[11] Les amendes peuvent être converties en emprisonnement au « tarif » de 0,50 F par jour. Les prisonniers peuvent être contraints à exécuter des travaux non rémunérés, en particulier sur des chantiers publics.
[12] Arrêté du 27/3/1914.
[13] Décret du 2/8/1922.
[14] Cette prétention est au cœur de la contradiction du système. Si la « coutume » était inscriptible dans le droit, elle ne serait plus arbitraire et ne remplirait plus sa fonction répressive extraordinaire. On peut noter qu’en Érythrée, les Italiens entreprennent sans succès de rédiger un « code pénal coutumier » entre 1903 et 1908.
[15] Deux arrêtés du 20/8/1924.
[16] Décret du 15/11/1924.
[17] Décret du 20/4/1927, exposé des motifs.
[18] Suret-Canale (Jean) [1962], Afrique Noire occidentale et centrale : l’ère coloniale, 1900-1945, Paris, Editions sociales, réed. 1964, p. 423.
[19] ANOM, 4E6/2 - Cercle de Djibouti, « Rapports 1932-1951 ».
[20] ANOM, 1E1/5-7, rapport annuel du cercle de Dikhil, 1937.
[21] ANOM, Affaires politiques, supplément non coté « Bernard », lettre du 15/11/1934.
[22] Idem, rapports de novembre 1948, décembre 1949, 1er trimestre 1950, 2e trimestre 1953 ; ANOM 4F2, rapport du cabinet du gouverneur du 24/8/1949 ; ANOM Affaires politique, non coté « Grèves », note du 7/11/1957.
[23] ANOM Affaires politique, non coté « Rapports politiques », rapport du 2e trimestre 1953.
[24] ANOM, Affaires politiques 697.
[25] ANOM, Affaires politiques 698/1 et Contrôle 811, mission Le Gregam, rapport du 9/2/1938.
[26] Les décès survenus en janvier 1935, dont l’administrateur Albert Bernard et seize miliciens lors d’un affrontement fondateur, ne sont pas inclus dans ces statistiques. Ils font l’objet d’une indemnité compensatoire versée par le gouvernement éthiopien en février 1935.
[27] ANOM, Affaires politiques 697.
[28] ANOM, Affaires politiques 703/6, rapport de Barthes, 2/1/1931.
[29] Introduction à Chaliand (Gérard), Blin (Arnaud), dir., Histoire du terrorisme, de l’Antiquité à Al Qaida, Paris, Bayard, 2004, 668 p.
[30] Décret du 2/9/1887, cité.
[31] Décret du 4/2/1904, cité.
[32] Arrêté du 27/5/1914.
[33] Arrêté du 25/3/1935.
[34] Arrêté du 31/3/1951.
[35] Depuis 1924, les anciens combattants, les notables et les agents de l’administration, ainsi que leur famille, « sont exemptés des punitions disciplinaires » (décret du 15/11/1924).
[36] ADN, Ambassade à Addis Abeba B26, note du 16/2/1945.
[37] Loi n°200/AN/81 www.presidence.dj.
Les adresses courriel ne sont pas affichées.